Cet article est réservé aux abonnés PREMIUM
Inscrivez-vous et abonnez-vous pour lire cet article et accéder à la bibliothèque complète des articles réservés aux abonnés PREMIUM.
S'inscire maintenant Vous avez déjà un compte ? Se connecterEn tournée en Europe, John Buck, conseiller en entreprise, a visité le Goetheanum et l’école Rudolf Steiner de Bâle. Andrea Valdinoci l’a interrogé sur l’origine de la « sociocratie » et la réussite des processus de direction mutuelle.
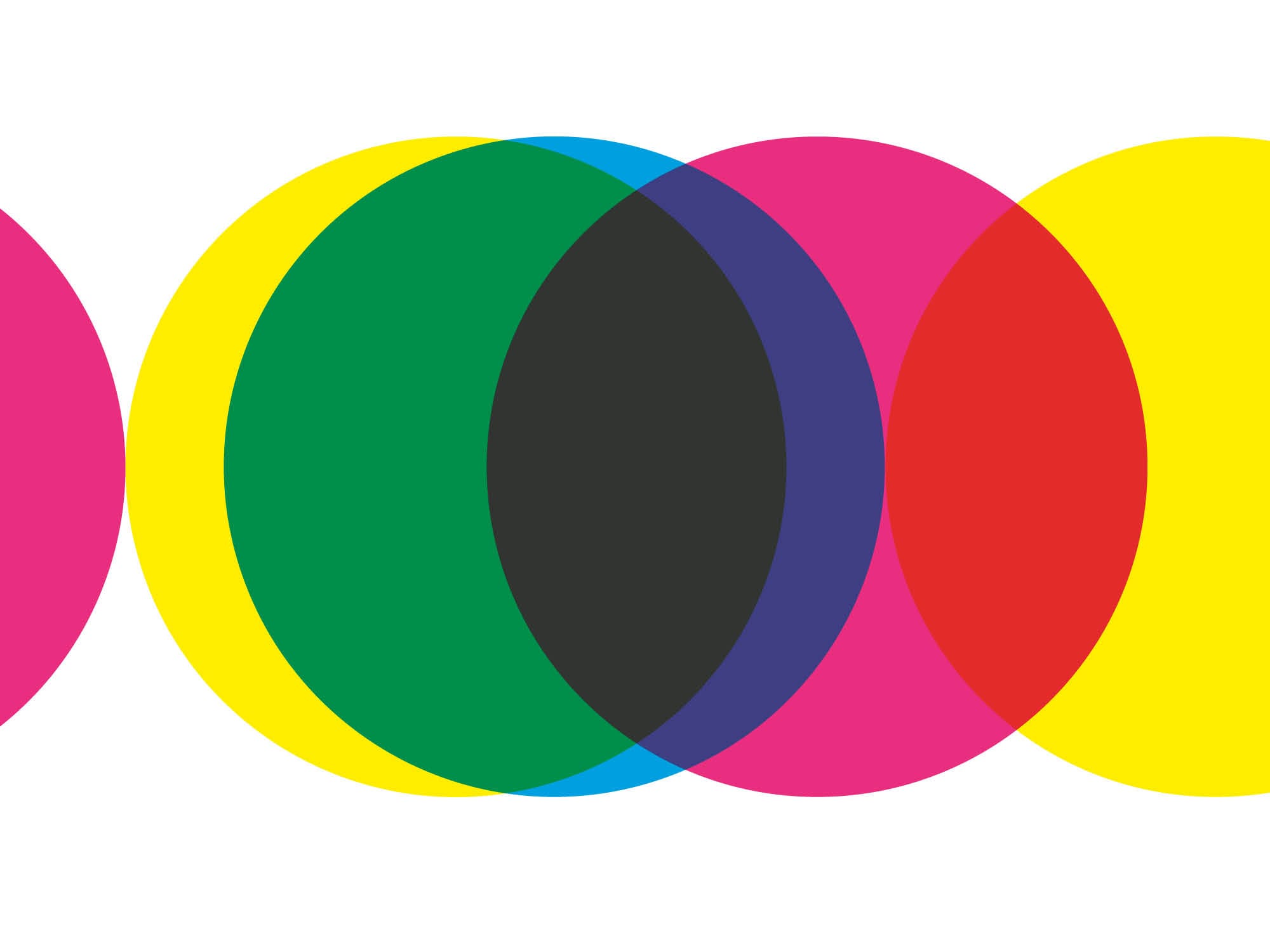
Inscrivez-vous et abonnez-vous pour lire cet article et accéder à la bibliothèque complète des articles réservés aux abonnés PREMIUM.
S'inscire maintenant Vous avez déjà un compte ? Se connecter