Ce que disait le philosophe
Dans son Éthique à Nicomaque, Aristote définit l’amitié comme une «bienveillance entre semblables». Selon lui, cette «bienveillance entre semblables» peut être liée soit à la jouissance, soit à l’utilité. Des exemples de ces deux formes de bienveillance parsèment nos vies, mais toutes deux souffrent d’une lacune: elles sont changeantes dans le temps. Mais existe-t-il une forme de bienveillance qui s’élève au-dessus de l’utilité et de la jouissance? Cela peut arriver lorsqu’une amitié devient «précieuse en soi», lorsque cette amitié devient une fin en soi. Il s’agit alors de l’amitié par «vertu» qui n’est accessible qu’au caractère noble. «Vertu» doit ici être compris dans un sens actif, comme une «aptitude morale».
L’amitié par vertu est liée à un échange d’égal à égal et à un intérêt réciproque. C’est avec beaucoup de modernité qu’Aristote attire l’attention sur une attitude intérieure: seul un homme vivant en amitié avec lui-même pourra engendrer de véritables amitiés. Les dissonances, les déséquilibres du caractère se manifestent inexorablement vers l’extérieur et déforment l’amitié. Seul l’homme harmonieux suscitera des amitiés harmonieuses 1.
Un archétype
Selon Friedrich Schlegel, «l’historien est un prophète qui regarde en arrière». Revenons donc sur un exemple du passé pour pouvoir délier des germes d’avenir. Il existe un exemple d’amitié bien documenté, il s’agit de la relation entre les poètes et penseurs Friedrich Schiller (1759-1805) et Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Au départ, leurs rapports n’étaient absolument pas amicaux, au contraire, leurs caractères, leurs parcours et leurs talents particuliers pouvaient difficilement être plus différents. Schiller, de dix ans plus jeune, de condition modeste, dut tout arracher au destin par des luttes incessantes, gravir son chemin au prix de grands efforts. Goethe, le surdoué issu de la haute bourgeoisie, doué d’une imagination florissante, fut élevé dans un environnement privilégié – un homme aisé à bien des égards. Ces deux personnalités durent vaincre des obstacles intérieurs, mais Schiller eut sans conteste à faire face aux plus grands obstacles.
Se dépasser soi-même
Dans les relations de Schiller, trois phases apparaissent clairement durant sa vie. Il y a d’abord les amitiés de jeunesse, dont fait partie le cercle de personnalités qui l’entourait à l’Académie Militaire de Stuttgart. Son amitié principale se joua avec Georg Scharffenstein, dont le jeune poète se sépara après que cet ami lui ait fait des reproches. Schiller évoque lui-même dans un courrier sa «sensibilité orgueilleuse»: voilà une merveilleuse et précise caractérisation de sa propre faiblesse! Les amitiés de jeunesse vivent d’instabilité et d’un excès qui s’affaisse ensuite à nouveau en lui-même. Elles sont très dépendantes des changements d’humeurs et se maintiennent rarement durant toute la vie.
Dans le cercle entourant Johann Gottlieb Körner, une nouvelle disposition d’âme entre en jeu. À Mannheim, Schiller reçoit une lettre exprimant non seulement une grande vénération pour son talent de poète, mais lui proposant aussi une aide concrète pour sa vie. Il l’accepte après de longues hésitations, mais il s’agit pour lui d’un événement réjouissant, quelque chose qu’il s’était toujours imaginé mais n’avait jamais osé espérer. Voilà que naît l’ode A la joie 2, sans doute le poème le plus célèbre de Schiller. Il s’agit aussi d’une «ode aux amis». Car cette joie première, d’avoir enfin atteint quelque chose dans le destin, est la source biographique de ce poème, tel un hommage poétique rendu par Schiller à ces rencontres salutaires. Les relations qui naissent avec Körner et son entourage ne seront jamais menacées. Elles se caractérisent par une complémentarité naturelle; on se ressent comme des «frères par choix». L’amitié avec Körner, malgré toutes les différences d’origines et de compétences, est vécue comme une rencontre d’égal à égal.
Mais les pas réalisés jusque-là ne suffisent pas. Sa fine sensibilité lui fait ressentir qu’il doit encore s’élever. Il veut coûte que coûte approcher Goethe. Mais de quelle façon? L’âme de Schiller est traversée des sentiments les plus contradictoires. D’un côté, il ne peut que reconnaître la grandeur de Goethe, comme poète et génie créateur. De l’autre, il doit lutter contre d’intenses sentiments de jalousie et peut-être aussi contre une certaine ambition. Sa forte capacité à l’autocritique lui permet de voir impitoyablement les différentes lacunes de son propre caractère et de sa formation. Il remarque aussi que l’élan de la jeunesse diminue peu à peu. Il va sur sa trentième année et doit maintenant trouver une attitude nouvelle, qui le stimule autrement.
La traversée du désert
On sait que Schiller met alors fin à son activité poétique. Au cours des années qui suivront, il s’adonne à l’aride domaine de l’abstraction philosophique. Il étudie Kant, se consacre à des questions d’esthétique qui conduiront à des écrits d’importance dans ce domaine. Mais ce n’est pas le véritable objectif. Il s’agit littéralement d’une traversée du désert. Voici une déclaration caractéristique de cette période: «Je philosophe volontiers sur la théorie à seule fin d’exercer; la critique 3 doit maintenant réparer les dommages qu’elle m’a causés; car elle m’a effectivement causé des dommages: l’audace, la flamme vivante qui m’habitait avant de ne connaître aucune règle m’a quitté depuis déjà plusieurs années.Désormais, je me regarde en train de former et de créer, j’observe le jeu de l’enthousiasme, et ma force d’imagination recèle moins de liberté, depuis que j’ai un témoin. Mais quand j’en serai arrivé au point où la part artistique deviendra en moi nature, comme l’est l’éducation à un homme bien élevé, l’imagination retrouvera aussi sa liberté d’antan et ne s’assignera plus aucune autre barrière que celle qu’elle se choisira.»
De quoi parle ici Schiller? La conscience intellectuelle se trouve nécessairement au point de départ. En tant qu’hommes modernes, nous ne pouvons lui échapper. Au départ, elle nuit aux capacités créatives, elle leur barre la route; comme la lance qui blesse gravement Amfortas 4. Mais si l’intellect est utilisé encore et toujours, si le Je l’emploie de manière vivante, il peut se métamorphoser. Il devient alors «œil» pur – comme un corps supérieur, une habitude supérieure. Un organe spirituel naît de la conscience réflective. Un observateur intérieur qui n’est plus dépendant du cerveau. Expérience que vit de même Perceval à la fin de sa quête, lorsqu’il porte la lance transformée, celle qui produit la transformation: «Une seule arme est bonne: seul referme la plaie, le javelot qui la causa.» 5
La forme supérieure de l’amitié
Par la science de l’esprit anthroposophique, nous connaissons bien cet observateur: il s’agit de la faculté de l’âme de conscience. Cette manière de la nommer n’est pas vraiment appropriée: il est question de la plus haute faculté de l’âme que nous puissions développer. Non seulement cette faculté est perçue par le Je s’il devient actif, mais elle consiste précisément en cette activité du Je. Schiller dut attendre jusqu’au moment où il a pu former cette faculté. Il devait entrer dans l’âme de conscience afin de rencontrer Goethe d’égal à égal. Cette partie de l’âme qui s’élève dans une activité libre voit l’esprit environnant s’ouvrir à elle. D’une faculté de réflexion subjective surgit quelque chose d’objectif. Novalis parle du «point lumineux en suspension», que le chercheur parvient à atteindre: un point de départ souverain. Par cette expression, il indique d’une part un état de libération du corps, d’autre part sa force d’éclairer par elle-même le spirituel. Ayant traversé un laborieux développement cathartique, Friedrich Schiller prend de plus en plus conscience de cette capacité. Dans une lettre à Goethe, il l’appelle aussi le «miroir pur», car il ne perd pas, bien entendu, son caractère de connaissance: «… la possibilité de vivre l’achèvement de cette production 6, et de pouvoir puiser à cette source pure, fait partie des plus belles chances de mon existence; et le beau lien qui vit en entre nous élève en quelque sorte pour moi au rang de religion le fait de faire ainsi mienne votre cause, de transformer tout ce qui en moi est réalité en le plus pur miroir de l’esprit, vivant dans cette enveloppe, et de mériter ainsi, au sens supérieur, d’être appelé Votre Ami.»
Voilà un passage clé concernant «l’ésotérisme de l’amitié». L’exotérique devient ici ésotérique. Schiller rattache expressément l’image du pur miroir à la sphère du religieux et à la forme nouvelle d’une amitié plus élevée. «Religieux» signifie ici concrètement le domaine du spirituel, pas une religiosité traditionnelle ou une certaine communauté religieuse. Il s’agit d’une expérience intérieure, d’un éveil tâtonnant dans un autre monde. Et la forme supérieure de l’amitié ne peut trouver de nourriture qu’en cet autre monde. Elle ne peut reconnaître qu’en lui son «fondement ultime». Non pas un rapport découvert par la logique, mais une expérience intérieure. Non pas une déduction philosophique, mais un événement profondément individuel, toujours à recréer.
Ce qui rayonnait de Goethe et Schiller du fait qu’ils étaient parvenus, de haute lutte, à agir ensemble, Rudolf Steiner le qualifia d’«archétype de communauté socio-spirituelle». Par-là, des forces fondamentalement originales sont entrées dans l’histoire spirituelle7.
La créativité commence dans le présent
Par leur action commune, Goethe et Schiller ont formé une substance qui perdurera. Une substance qui recèle un caractère archétypal pour toute personne qui s’y rattache. Nous savons que chaque motif de la destinée est irremplaçable et unique. La créativité commence dans le présent.
Quels mouvements d’âme doivent être exercés pour s’engager dans cette direction? Le modèle que nous trouvons chez Schiller nous a fait découvrir la faculté d’autocritique. Si je donne forme à mon homme supérieur, alors je ne réponds plus immédiatement, comme avant, aux critiques provenant de l’extérieur. Je deviens de plus en plus un observateur de ma propre âme, et je peux mieux différencier ce qui est passé, ou ce qui est éphémère, de la véritable essence. Une critique assénée injustement ou sur un ton blessant me touchera autrement si j’apprends à la considérer à partir du «point lumineux en suspension».
La formation du «miroir pur» permet de porter un regard sans préjugés sur les forces et les faiblesses de l’autre. Pour l’autre, l’ami, je deviens potentiellement un conseiller plus précis et plus intime concernant les questions intérieures. C’est à dessein que je dis «potentiellement», car l’ensemble doit se jouer dans un espace de liberté des plus clairs; comme pour les potentiels présents entre Goethe et Schiller qu’ils durent tous deux explorer à tâtons.
L’échange spirituel fait nécessairement partie l’amitié supérieure, mais aussi un intérêt beaucoup plus élevé envers les préoccupations de l’autre. Il s’agit de cette bienveillance dont parle Aristote, mais élevée à l’usage le plus libre. Cet intérêt me permettra, lors de décisions importantes, de laisser agir sur moi le jugement de l’ami(e) presque comme s’il s’agissait du mien. Il se révélera peut-être que le jugement de mon partenaire est bien plus pertinent à long terme et plus profond que ma propre impression. De telles expériences rendent prudents et enseignent à attendre d’abord calmement avant de prendre une décision. Au fond, notre horizon personnel de jugement peut ainsi être élargi au-delà de lui-même. Il est inutile de préciser ici les effets qui en résulte pour notre environnement et chaque situation sociale.
L’air d’Emmaüs
Une relation liée aux forces de l’amitié supérieure devient fertile en idées spirituelles. La vie de l’esprit attend que naissent des amitiés au sens de l’âme de conscience. Je suis profondément convaincu que tout dépendra de plus en plus, à l’avenir, de tels liens d’amitié. Mon expérience m’a aussi montré que par la véritable amitié, qui implique toujours un dépassement de soi, des impulsions nouvelles et créatrices peuvent entrer dans la société; des idées auxquelles personne n’aurait pensé, des forces que personne n’aurait osé espérer, des dépassements de soi auxquels personne n’aurait cru.

L’union créatrice avec ce qui nous est opposé, voilà ce qui manque cruellement aujourd’hui. Car l’esprit peut alors envoyer ses inspirations. L’union créatrice avec l’antagonisme n’est possible que si les personnes concernées traversent de réels processus de mort. Le serpent doit muer avant de pouvoir poursuivre sa route sous une forme nouvelle et plus belle. Tout comme Schiller était prêt à prendre sur lui sept années de transformation, car il savait qu’une force supérieure sommeillait en lui, qui voulait se manifester. Par cette compréhension, l’ancien idéal de l’amitié peut trouver une nouvelle naissance, traverser une réelle résurrection. Il s’avance alors dans le domaine de l’ésotérisme chrétien. Il devient un événement spirituel qui perdurera à jamais. Car il respire «l’air d’Emmaüs», comme l’écrit Peter Handke lorsqu’il décrit précisément cette atmosphère qui naît. Et, comme la présence toujours créatrice de la relation entre Goethe et Schiller, cet air a une action créatrice dans le monde. L’ésotérique ne reste pas fermé sur soi, il rayonne et féconde l’exotérique, en le transformant.
«Qui ne cherche pas son ami, N’est pas son propre ami.»
Paru initialement dans l’hebdomadaire Das Goetheanum.
Traduction: Louis Defèche
Notes de l'article
- Aristote, Ethique à Nicomaque.
- An die Freude
- Note de l’auteur : la « critique » au sens épistémologique.
- Souverain du royaume du Graal, il est également nommé le « roi pêcheur ». N.D.L.R.
- Wagner Richard, Parsifal, acte 3, scène 2.
- Goethe, Les Années d’apprentissage de Wilhelm Meister.
- Steiner R., GA 337A.
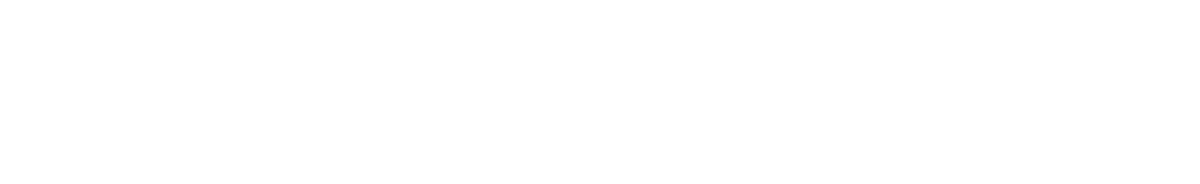
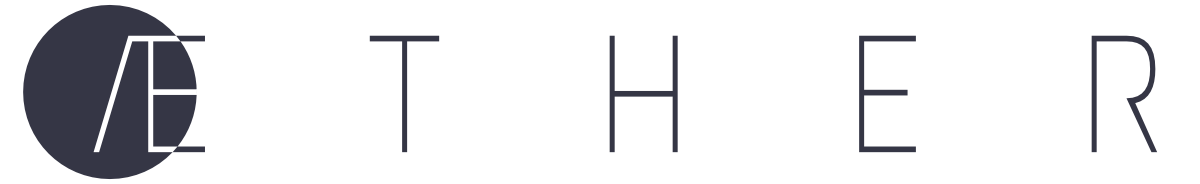







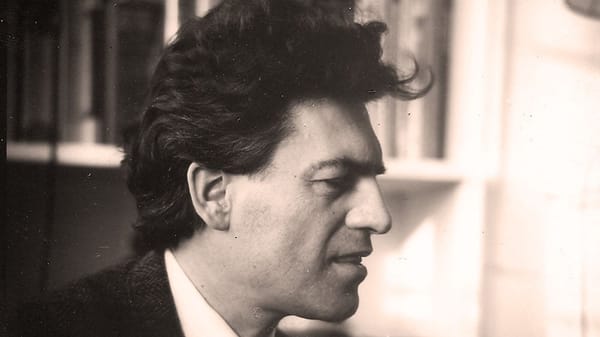

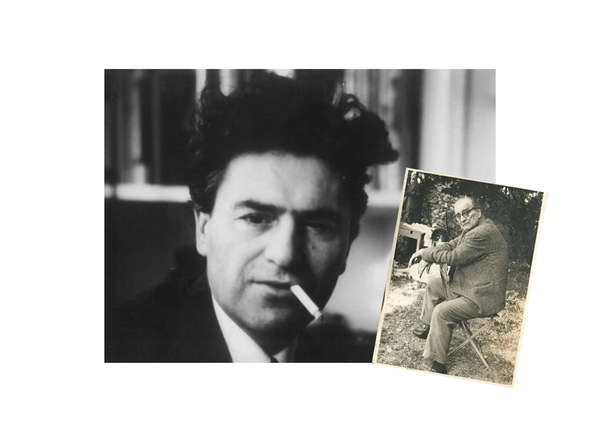
Discussion pour membres