Si l’on est proche des conceptions de Rudolf Steiner, on trouvera en principe souhaitable que d’autres jettent un jour un œil sur son œuvre. Mais il est possible que l’on éprouve en même temps des sentiments mitigés à l’égard de sa démarche. Que se passe-t-il lorsqu’une personne correctement éduquée selon les critères habituels se trouve confrontée par exemple à la cosmologie de Steiner ?

Selon l’anthroposophie, la Terre telle que nous la connaissons aujourd’hui serait née d’« un état spirituel de notre planète ». Et avant cet état spirituel, il y aurait déjà eu des stades matériellement plus denses. Au total, la Terre aurait traversé « trois états planétaires densifiés, entre lesquels se trouvent toujours des états intermédiaires spiritualisés ». Voilà certes un récit de l’histoire de l’univers pour le moins inhabituel à notre époque.
Et il en va de même pour les déclarations de Steiner sur l’être humain. Elles aussi ne peuvent guère être mises en relation avec ce que dit la science aujourd’hui reconnue. Cela ne vaut pas seulement pour ses descriptions des étapes de la vie après la mort, mais aussi pour ce qui concerne les constituants de l’être humain (corps physique, corps éthérique, corps astral et autres). Tout cela se présente comme un modèle à part – beaucoup diront : étrange – à côté de ce qui est enseigné aujourd’hui. Ceux qui étudient la médecine ou la psychologie ne rencontreront guère une telle anthropologie.
C’est un constat irritant. Les conceptions de Steiner semblent très éloignées de ce qui constitue aujourd’hui un standard intellectuel. Et l’irritation ne fera sans doute que croître quand on apprendra que Steiner tenait à ne pas être le créateur d’une vision du monde séparée et fantaisiste, mais à être en plein accord avec la science moderne. Une divergence extrême donc, pour une prétendue harmonie : comment comprendre cela ?
Bien entendu, Steiner était conscient qu’il y avait là de grandes questions à résoudre ; qu’il fallait montrer comment ces différents points de vue s’articulent entre eux. Il est évident qu’ils ne sont pas liés de manière que les enseignements de Steiner se situent pour ainsi dire dans la ligne, dans le prolongement du savoir actuel. Le rapport doit être d’une autre nature.
Steiner a parfois essayé d’illustrer la forme que cela peut prendre par des comparaisons. Par exemple en prenant l’image d’un tableau. On peut en effet aborder un tableau de deux manières différentes. Tout d’abord par une analyse des pigments utilisés, des forces par lesquels ils adhèrent à la toile, de l’application des couleurs et d’autres aspects similaires. « Mais – poursuit-il –, avec tout cela, on ne rencontrera pas ce qui se révèle dans le tableau. Dans cette révélation, qui est là à travers l’image peinte, vivent des lois tout à fait différentes de celles qui peuvent être obtenues à partir des points de vue indiqués ». On pourrait dire la même chose de l’homme. Là aussi, il est possible d’acquérir de nombreuses connaissances sur le plan matériel et d’appliquer les lois des sciences physiques, de la pression sanguine aux processus moléculaires dans les cellules, etc. Cependant, selon Steiner, quelque chose se révèle dans l’être humain « qu’on ne peut saisir par les points de vue à partir desquels on élabore les lois de la nature extérieure ».1
Ce qui est évident pour une œuvre d’art, à savoir qu’à l’analyse de sa nature matérielle doivent s’ajouter d’autres formes de compréhension, est également valable pour l’homme. On peut retenir ici l’idée fondamentale que différentes approches de la connaissance et différentes formes d’expression peuvent très bien s’accorder sans contradiction.
Cette idée n’est pas nouvelle. Et comme certaines approches sont plus faciles que d’autres, elle a toujours été un sujet difficile. Ce n’est pas un hasard si l’on a toujours parlé en paraboles, car elles sont les plus à même de suggérer des relations complexes et non linéaires. Le fait que Jésus ait parlé en paraboles n’est pas une simple lubie. Il en allait de même, un demi-millénaire plus tôt, pour Bouddha.
Dans la parabole de l’aveugle-né, ce dernier évoque déjà l’importance des différents niveaux de connaissance. Un roi, dit-il, a réuni tous les aveugles de naissance des environs, puis il a placé un éléphant au milieu d’eux et leur a demandé « À quoi ressemble un éléphant ? » L’un d’eux, en touchant son ventre, le trouva semblable à un mur. Celui qui a saisi un pied l’a vu comme une colonne. Le jugement porté sur la défense : un éléphant ressemble à un soc de charrue. Enfin, le résultat à l’extrémité de la queue : il ressemble à un balai. Tous ont raison à certains égards, et tous manquent l’essentiel. « Il en va de même, moines, pour les ascètes itinérants. Aveugles et sans yeux, ils ne distinguent pas ce qui est important et ce qui ne l’est pas ».2
Chez Bouddha, la parabole vise avant tout à trancher la querelle des dogmes et des vérités partielles. Mais en même temps, la parabole évoque ce que serait la vérité totale : lorsqu’on voit l’éléphant. En fin de compte, et c’est le sens profond de cette histoire, tous les hommes sont nés aveugles, même les fiers ascètes sont « sans yeux » et doivent d’abord apprendre à voir ce qui est réellement.
Évoquer cette différence : la différence entre la manière ordinaire et une manière plus claire et plus complète de se tenir dans le monde, était déjà inconfortable à l’époque d’un Bouddha, d’un Lao Tseu ou d’un Jésus. Bien entendu, les farouches défenseurs du point de vue dominant se sentaient toujours dérangés par de telles références. Pourtant, dans toutes les cultures prémodernes, une chose était indiscutable : qu’une telle conscience supérieure pouvait en principe exister ; que certaines personnes – éveillés, prophètes, saints – pouvaient en quelque sorte parler depuis un autre niveau du monde et une compréhension supérieure.
C’est différent aujourd’hui. Sur ce point, à l’époque moderne, quelque chose s’est déplacé. La tendance de notre époque est en effet de n’admettre qu’un seul niveau du monde, de ne considérer qu’un seul niveau de description comme pertinent : celui des sciences modernes. Elles seules semblent garantir des vérités sûres. Toutes les autres formes de compréhension du monde ne sont pas purement et simplement éliminées (bien que de telles tentatives aient eu lieu, de la Révolution française au socialisme « scientifique »), mais elles sont dévalorisées de manière globale. Elles sont considérées comme de simples « croyances », des interprétations du monde vénérables mais finalement arbitraires, et se voient attribuer une place plus ou moins anecdotique au sein du patrimoine culturel. Tel est l’arrangement des temps modernes, avec lequel les deux partis se sont plutôt bien arrangés.
Si l’on y réfléchit tant soit peu, c’est un scandale. Cela signifie en effet qu’une optique aussi vaste et aussi différente des modes de pensée dominants que l’optique religieuse ne s’exprime plus que dans des niches au lieu d’entreprendre la difficile tentative de s’expliquer elle-même ; tentative difficile en tout cas si l’on ne veut pas seulement répéter (dans le style des fondamentalistes) d’anciennes formules traditionnelles.
Dans ce contexte, la place de l’anthroposophie dans l’histoire de l’esprit devient claire. Elle soutient que les espaces qui sont aujourd’hui tombés dans l’arbitraire de la croyance ou de la non-croyance privées sont les espaces décisifs de la connaissance du monde ; et qu’il peut très bien y avoir – aujourd’hui aussi – des formes supérieures de connaissance. Seulement, le chemin qui y mène à notre époque doit être différent de celui d’autrefois, car la constitution de l’âme humaine, selon Steiner, a fondamentalement changé.
C’est ici que l’on découvre un point central de sa pensée : la science de la nature, qui a agi pendant des siècles comme une entreprise de démolition spirituelle, contient justement la clé de la spiritualité de l’avenir. Mais non en transposant grossièrement ses schémas de pensée dans un autre domaine, du monde matériel au « monde spirituel », qui obéit à des lois totalement différentes. Ce qu’il importe absolument de retenir, c’est le profond apport invisible des temps modernes : leur esprit de recherche rigoureux et froid. Celui-ci, qui s’est formé dans la connaissance de la nature extérieure, portera ses fruits d’une tout autre manière dans la connaissance du monde spirituel.
Tout cela est, sans aucun doute, extrêmement exigeant. En résumé : il existe une forme de connaissance reconnue aujourd’hui qui est très performante, mais qui n’atteint pas certaines compréhensions. Celles-ci sont pourtant accessibles, avec une rigueur similaire, par d’autres voies. Et elles ne sont en aucun cas une sorte d’ingrédient ou de superstructure sans liens avec le connu, mais constituent ce qu’il y a de plus profond et de plus complet. C’est même à partir de là que ce qui est apparemment connu devient compréhensible.
Steiner a toujours essayé d’illustrer ces faits abstraits. De même que l’allégorie du tableau montre au moins la différence entre deux approches légitimes d’un même objet, il a développé d’autres représentations qui sont plus complexes et plus dynamiques. Dans l’une d’entre elles, des « tableaux » jouent également un rôle :
Imaginons une structure, « savamment empilée à partir de rouleaux de papier ».3 Chacun d’eux, enroulé, contiendrait « un tableau splendide » qui, logiquement, ne serait pas visible de l’extérieur. Autre condition supplémentaire (nous ne pouvons pas nous en sortir de manière aussi élégante que dans la parabole de l’éléphant de Bouddha) : les tableaux sont des « images vivantes et actives » qui se sont superposées elles-mêmes pour former cette structure. Cela aussi, on ne peut guère le deviner en regardant les rouleaux de papier. « Vous voyez, il en est ainsi de la science extérieure. Elle décrit cet ingénieux édifice, mais elle n’accorde aucune attention aux tableaux qui sont sur chacun des rouleaux ». Et quelque chose d’autre encore est suggéré ici, c’est que « la science ordinaire ne peut d’abord pas du tout en venir à la conclusion que ce spirituel est à la base de notre édifice cosmique ». Cette compréhension ne peut en effet pas être obtenue par une analyse de la structure des rouleaux de papier, aussi précise soit-elle, puisqu’il faut d’abord « faire soi-même quelque chose » : il faut prendre des rouleaux et les dérouler ! « C’est ce qui est aujourd’hui si difficile à reconnaître pour la culture extérieure, plongée dans le matérialisme » : que la connaissance implique en même temps de l’activité, et que les possibilités de connaissance ne peuvent pas être détachées du sujet connaissant. (La physique moderne peut percevoir l’ébauche d’une telle compréhension dans le domaine subatomique, où aucune observation n’est possible sans influencer ce que l’on observe).
Certes, une parabole n’est pas une preuve. Il existe aussi des métaphores trompeuses. Mais ce que les métaphores peuvent faire, c’est rendre pensables certaines relations du monde qui, jusque-là, n’étaient pas accessibles à la pensée, et peut-être même déclencher un renversement de perspective. En l’occurrence, il s’agit de la possibilité que derrière ce qui est considéré aujourd’hui comme une connaissance sûre se cache quelque chose de décisif : que cet « autre », ce qui est caché, puisse éclairer ce qui est présumé connu, parce que celui-ci est organisé à partir de celui-là. Les époques précédentes n’exprimaient rien d’autre à leur manière lorsqu’elles partaient du principe que le monde visible n’est compréhensible qu’à partir d’un invisible (Dieu, Esprit, Tao…).
Bien entendu, chacun est libre de voir dans tout cela de la pure spéculation et de s’en tenir à ce qui est clairement et solidement démontrable, comme l’analyse des couleurs et des pigments sur la toile. Au risque de ne pas voir qu’un esprit comme Rembrandt a organisé les couleurs que l’on voit. Il ne s’agit pas d’autre chose lorsque Steiner reconnaît d’une part les performances de la science moderne et parle en même temps de sa « grandiose superficialité ».
Cette superficialité est plus qu’une regrettable faiblesse de la connaissance. Elle conduit toujours plus loin dans une culture prisonnière d’une mécanique morte, qui ne peut pas construire une compréhension de l’essence profonde de l’homme et du monde. Une telle compréhension est pourtant vitale si l’on veut édifier un avenir humain.
Wolfgang Müller dans « L’anthroposophie, la provocation ? »
Le chapitre mis à disposition par les Éditions Triades.
Lire aussi la critique du livre sur le BLOG de la Société anthroposophique en France.
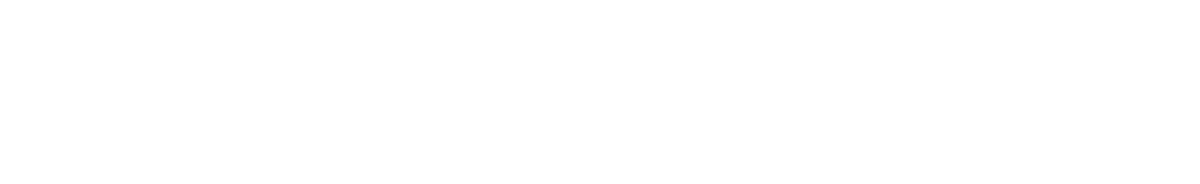
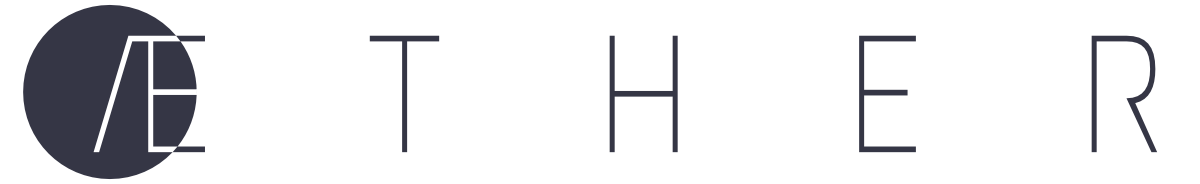









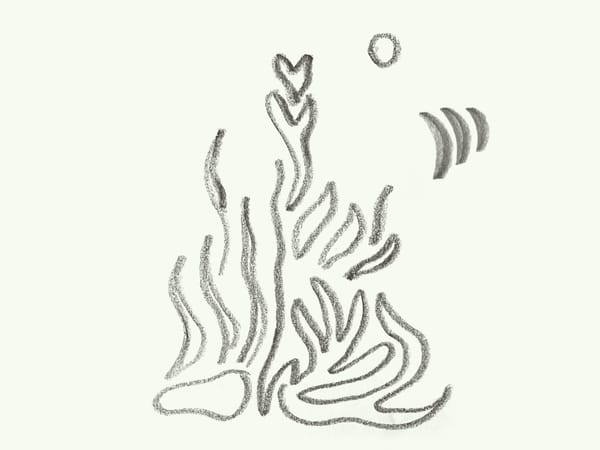
Discussion pour membres